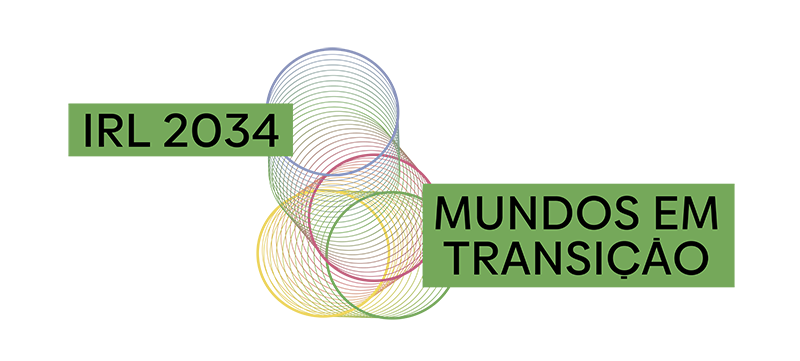
Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
Coordination: Fabrice Bardet et Guilherme Moura Fagundes
Dès lors que la question environnementale a été constituée en problème public à la fin des années 1960, les SHS se sont mobilisées sur l’étude des agents et forces de la réforme, aujourd’hui appelée transition ou bifurcation. Le contexte de l’Anthropocène et l’urgence environnementale qui le caractérise renouvellent les questionnements. En raison de l’ampleur et de l’urgence des changements environnementaux globaux, l’ensemble des agendas sociétaux se recomposent, pas seulement ceux des responsables politiques ou économiques, mais aussi ceux des chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, qui font évoluer leurs objets, terrains, questions de recherche et méthodes. Ce contexte appelle des réflexions transversales qui s’intéressent à la fois aux zones rurales et urbaines et aux relations et échanges entre elles, aux différents acteurs et secteurs économiques. Il requiert la mobilisation de manière croisée les connaissances de diverses disciplines, notamment en économie, sociologie et science politique, géographie, droit, écologie, histoire, anthropologie, philosophie…
L’analyse des politiques environnementales a permis dans un premier temps de décrire la difficile institutionnalisation du secteur de l’action environnementale à l’échelle nationale. Avec la remise en cause des puissances publiques et la libéralisation des économies, les formes d’action publique ont été réorientées vers de nouveaux modèles où les acteurs privés jouent un rôle central dans le financement, la mise en œuvre ou la régulation des programmes d’action : mise en place de marchés de droits à polluer, réforme des outils de comptabilité d’entreprises intégrant des indicateurs ESG (environnement, social, gouvernance), développement de marchés de la finance verte, etc. De fait, les instruments des politiques publiques sont aujourd’hui variés. D’une part, ils se concentrent sur le comportement des agents, et reposent sur le recours aux institutions et normes juridiques (normes contraignantes ou incitatives ; responsabilité ; propriété). D’autre part, ils exigent de nouveaux systèmes de prise de décision collective participative, qui valorisent des aspects tels que les connaissances traditionnelles des différents groupes sociaux ou l’ouverture au dialogue avec la science.
Les efforts visant à élaborer des réponses adéquates à ce défi sont également conditionnés par les actions d’acteurs et groupes sociaux et professionnels clés, tels que les juges, les classes moyennes émergentes, les secteurs d’activité et le secteur financier, qui stimulent ou freinent les progrès dans l’élaboration de réponses adéquates aux enjeux.
Au cœur de ces politiques qui visent à inciter ou réguler la transition se pose la question des outils de chiffrage : quels sont les « bons comptes » des futures politiques de la transition ? Comment pouvons-nous mesurer la transition, quels outils, quelles méthodes, quelles limites ? Derrière la question en apparence naïve, une ligne de débat est cruciale : comment concilier les objectifs de durabilité qui nécessitent des comptes sur le temps long avec les objectifs de la rentabilité financière qui imposent plutôt le court terme ?
Cette ligne de recherche peut être déclinée dans tous les secteurs de l’action publique et de la société : l’industrie et les services économiques, l’aménagement des villes et du territoire, les secteurs de l’action sociale ou de la protection environnementale.
Elle nécessite de prendre en compte la dimension historique des politiques et « transitions » environnementales. On ne peut par exemple comprendre les ambiguïtés de la gestion des forêts au Brésil sans faire un retour sur 500 ans de politiques et de gestion des espaces forestiers.
La comparaison France-Brésil est d’autant plus intéressante que ce ne sont pas les mêmes questions environnementales qui sont sur le devant de la scène dans les deux pays. Par exemple, la question (de la transition) énergétique et des émissions de CO2, ou encore de l’imperméabilisation des sols, se structurent en France, alors qu’au Brésil ce sont la déforestation ou l’agriculture paysanne/agrobusiness qui sont au cœur des débats actuels. Au-delà des politiques sectorielles, ce sont aussi les structures du financement des politiques de transition qui sont également très distinctes et susceptibles d’être interrogées : marché européen du carbone d’un côté, aujourd’hui très questionné, volonté de refondation des circuits financiers internationaux de l’autre, ou places financières de Paris ou São Paulo qui cherchent à se hisser aux premiers rangs mondiaux en revendiquant différemment des labels de distinction, en matière écologique ou éthique.
Ainsi, Mondes en transition fournira, dans le cadre de l’axe 5, un espace pour penser à la fois les acteurs (jeux de pouvoir, coalitions, mobilisations, rôle du juge) et les instruments économiques et juridiques (comment se construit la politique par l’intermédiaire du droit) et les circuits de financement de la transition environnementale amorcée. Les recherches s’intéresseront aussi aux fondements des politiques environnementales : les sources de la propriété et la propriété à l’heure de la transition ; les libertés fondamentales ; la relation à l’environnement et au-delà au vivant. Incluant la philosophie et plus largement les humanités environnementales, le projet appelle aussi une réflexion sur les ontologies politiques, et la nécessité de dépasser une vision très occidentale fondée sur le dualisme nature/culture, et de renouveler les approches en intégrant les ontologies politiques autochtones, mais également afro-descendantes ou paysannes. Il permettra de s’interroger sur l’habitabilité de la planète : et de relancer la réflexion épistémologique fondamentale des sciences humaines à l’heure de la bascule anthropocène et du nouveau jaillissement des sciences du vivant avec lesquelles les hybridations sont appelées de toutes parts. Le champ académique brésilien des SHS, plus encore que d’autres alimenté par son école anthropologique au puissant héritage structuraliste, constitue de ce point de vue une terre privilégiée à partir de laquelle conduire le chantier de l’éventuelle refondation.
Parmi les hot spots de biodiversité à l’échelle mondiale grâce à des biomes riches, variés et à la présence de nombreuses espèces endémiques (Amazonie, Cerrado…), clé pour l’équilibre du système climatique mondial, le Brésil est aussi aux avant-postes pour les conséquences des changements climatiques (sécheresse accrue, inondations…). La Guyane française se présente comme un terrain possible de comparaisons avec l’Amazonie brésilienne et au-delà dans une approche plus globalement pan-amazonienne.
En lien avec les axes 1, 2, 3 et 4, les projets de recherche développés dans le cadre de l’axe 5 pourront porter sur des questions de recherche transversales et générales : forces et agents des transitions (gouvernement, secteur privé notamment agrobusiness, systèmes financiers, justice…), forces régressives (lobbies par exemple) et forces motrices (exemple du mouvement de la Marche des Margaridas, du MST, des associations pour la reconnaissance légale des terres communes, nouvelles formes de mobilisation, procès climatiques, etc.), chiffres et outils de chiffrage de la transition environnementale, efficacité ou renouvellement des outils des politiques environnementales (normes contraignantes ou incitatives, outils économiques, financiarisation, planification…), réflexion sur les ontologies politiques et leur renouvellement. Ces questions seront traitées et nourries par des recherches interdisciplinaires empiriques sur des objets/domaines de recherche déterminés : villes, forêt, climat et transition énergétique, solutions fondées sur la nature, biodiversité, systèmes agroalimentaires, océans.
Voir les autres axes du projet :
- Axe 1 — Circulations, mobilités et espaces transnationaux
- Axe 2 — « Faire monde » dans la diversité des langues et cultures
- Axe 3 — Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
- Axe 4 — Mutations du droit et de la démocratie
- Axe 5 — Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
