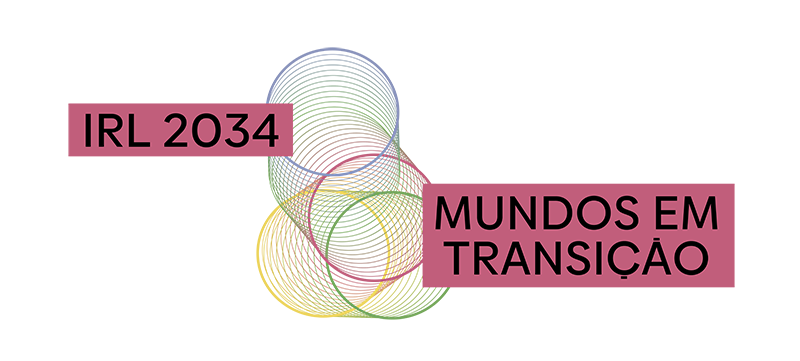
Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
Coordination: François-Michel Le Tourneau
Qu’elles soient climatiques, démographiques ou technologiques, qu’elles concernent les modes de vie, la santé, ou le travail, les transitions qui affectent le monde contemporain interrogent les inégalités. Ces grandes évolutions sont susceptibles de renforcer, atténuer ou faire émerger de nouvelles disparités. Rebattent-elles les cartes ou bien n’affectent-elles pas fondamentalement les inégalités de classe, de race ou de genre que nous connaissons ? De nouvelles formes d’inégalités apparaissent-elles, par exemple entre ceux qui sont en mesure d’adapter leur environnement aux changements climatiques et les autres ? Les processus de transition ne se déroulant pas tous à la même vitesse ou avec la même ampleur, de nouvelles distorsions se font-elles jour, par exemple entre des inégalités de genre qui tendent à se réduire et des inégalités environnementales dont les effets sont de plus en plus prégnants ? Ou au contraire se cumulent-elles ? Ce contexte appelle une discussion approfondie sur la notion même d’inégalités.
La question des inégalités est évidemment centrale dans un laboratoire liant la France et le Brésil autour des mondes en transition. Les deux pays se situent aux deux extrémités des comparaisons internationales sur les inégalités socio-économiques ; le Brésil se classant parmi les plus inégaux au monde et la France parmi les plus égalitaires de ce point de vue. En outre, si les inégalités tendent à se réduire au Brésil depuis 1990, quand elles restent remarquablement stables en France sur la même période cette question mérite d’être interrogée dans le temps long et doit s’intégrer, au-delà de la comparaison entre les deux pays, aux débats contemporains en histoire économique sur la mesure et les dynamiques des inégalités sur la longue durée et qui impliquent aussi bien historiens qu’économistes et sociologues.
Cette question des inégalités structure les sociétés et le débat public des deux côtés. Ainsi, autrefois naturalisées, les inégalités sont devenues un élément fort du débat et des politiques publics brésiliens, spécialement en ce qui concerne le croisement de la classe et de la race. Sans qu’elles doivent être limitées au Brésil et à la France, ces éléments montrent la pertinence d’effectuer des croisements de questionnements et des comparaisons, par exemple ceux de la représentation des inégalités, mais encore celle de l’efficacité et de la perception des politiques publiques et plus largement des mécanismes redistributifs qui les régulent. En France, l’idée d’égalité a été centrale dans la construction historique de l’État providence en France. Les niveaux d’inégalités économiques et d’accès aux services y sont relativement faibles. Mais le modèle français connait néanmoins lui aussi des tensions et des remises en question, dont certaines sont assez anciennes (politiques de la ville dans les quartiers) et d’autres bien plus récentes (nouvelles formes de contestations sociales, gilets jaunes). Mieux comprendre la reconfiguration des inégalités sociales présentes aujourd’hui au cœur de la société française nécessite d’analyser la crise actuelle du modèle républicain d’intégration, qui pose la question de l’immigration, la crise scolaire, les questions ethniques et le lien à la religion, mais aussi le sentiment de paupérisation et déclassement des classes moyennes notamment en lien avec la crise énergétique. L’analyse concrète des dynamiques politiques récentes suggère la persistance de fortes inégalités organisées autour d’autres clivages.
Reste que dans les deux pays, les évolutions historiques et contemporaines sont complexes. Des phases d’atténuation ou de mise à l’agenda des inégalités sont suivies d’augmentation ou de fermeture du débat public. De nouvelles questions émergent aussi, qu’elles soient portées par des groupes sociaux ou des institutions sur le long terme ou bien que des situations de crise à certains moments et dans certains territoires les imposent. Ceci renvoie aux causes des évolutions des inégalités et donc aux transitions politico-économiques, environnementales ou démographiques précédemment évoquées, ainsi qu’à leurs interdépendances.
Les inégalités sont un objet profondément travaillé des sciences sociales brésiliennes et françaises. Cet héritage intellectuel, théorique et empirique, représente un formidable répertoire à partir duquel les travaux de l’axe pourront se positionner. L’enjeu sera dès lors de le renouveler ; de deux façons au moins. D’une part, ces travaux adopteront systématiquement l’optique des transitions. D’autre part, ils croiseront les approches de ces deux espaces, y compris pour éclairer différemment d’autres aires géographiques. Pour ne prendre qu’un exemple, la question des effets inégalitaires des plateformes et de l’ubérisation sur l’emploi se lit différemment en fonction de la place de l’emploi informel dans la société, le Brésil et la France offrant deux situations très contrastées de ce point de vue.
S’agissant des facteurs d’inégalités, les travaux engloberont les inégalités de classe, de race et couleur de peau, ethniques, de genre, régionales, géographiques, spatiales, de santé, de culture, d’éducation, de générations, etc. L’axe 3 ne détermine pas de facteurs, de critères, d’espaces ou de modalité d’analyse privilégiée des inégalités. Il s’agit néanmoins d’affirmer d’une part le lien avec des transitions en cours et d’autre part les inégalités cumulatives, autrement appelées intersectionnelles. Parce qu’elles sont par nature relationnelles, l’étude des inégalités devrait porter sur l’ensemble des situations et du spectre sociaux, des plus pauvres aux plus riches, des plus exclus aux mieux inclus, des plus ségrégués aux plus mélangés ; la France et le Brésil offrant là encore une large palette de situations et de trajectoires. Une autre question centrale concerne le rôle de l’État et des pouvoirs locaux dans la production et la reproduction des clivages (et des niveaux) d’inégalités, en lien avec l’axe 4 s’agissant du traitement juridique des discriminations.
Pour analyser ces situations et trajectoires, l’axe de recherche se propose de s’attacher à la fois aux dimensions temporelle et spatiale des inégalités. S’il s’agit de prismes d’analyse classiques et incontournables de cet objet, leur intérêt se renouvelle dès lors qu’ils sont rattachés à la question des transitions. La dimension temporelle est seule à même de mettre à jour les effets des transitions en cours ayant lieu par exemple dans les domaines économiques ou technologiques, ainsi que des politiques et instruments qui les régulent. L’approche territoriale et les enjeux scalaires prennent quant à eux un sens nouveau à l’aune des transitions, par exemple pour l’étude des inégalités environnementales.
Enfin, en termes de sources et de méthodes, la mesure et la caractérisation des inégalités sont systématiquement porteuses d’interrogations et de défis quant aux catégories, aux données et aux échelles mobilisées. Cet enjeu est encore renforcé dans les comparaisons internationales. Par exemple, des statistiques publiques sur les catégories raciales sont produites au Brésil sur la base d’auto-déclarations, ce qui n’est pas le cas en France. Toujours est-il que l’accès aux données et les capacités d’ingénierie que permettra l’IRL apparaissent comme une formidable opportunité pour aligner, géo-référencer et traiter des données, y compris massives. Les coopérations en son sein pourront ainsi permettre un saut qualitatif et quantitatif et donner lieu à la création de bases de données et d’atlas. Ces travaux incluront un questionnement sur les données en elles-mêmes : la construction des catégories, les conditions de production de ces données, leur champ de validité, mais aussi l’identification des données manquantes ou imparfaites et les raisons de ces défauts. Enfin, les travaux conduits dans cet axe auront à cœur de rechercher et valoriser des collaborations avec la société civile, en capitalisant notamment sur l’expertise des chercheurs brésiliens dans ce domaine.
Voir les autres axes du projet :
- Axe 1 — Circulations, mobilités et espaces transnationaux
- Axe 2 — « Faire monde » dans la diversité des langues et cultures
- Axe 3 — Transitions socio-économiques et dynamiques des inégalités
- Axe 4 — Mutations du droit et de la démocratie
- Axe 5 — Transitions environnementales à l’ère de l’Anthropocène
